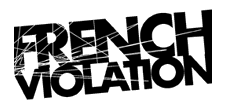Le Monde 06 06 2005
"Plus qu'une discothèque, le Palace était un lieu culturel." C'est ainsi que Paquita Paquin, aujourd'hui rédactrice chargée de la mode à Libération, définit le club ouvert à Paris par Fabrice Emaer en 1978. De 1979 à 1983, elle en fut la physionomiste, celle qui autorisait l'entrée dans ce haut lieu de la nuit parisienne. Ou la refusait. D'elle dépendait ce mélange si particulier de "bourgeois, mondains, loubards et modernes" qui faisait la réputation du club de Fabrice Emaer. Vingt-cinq ans après, l'époque fascine encore.
Au mois d'avril 2005, le magazine De l'air consacrait sa couverture aux années Palace ; Paquita Paquin vient de publier un livre de souvenirs (Vingt ans sans dormir, 1968-1983) chez Denoël ; et le même éditeur publie le recueil des articles d'Alain Pacadis, chroniqueur nocturne pour Libération, parus entre 1973 et 1986. Revers de cette fascination : une nostalgie persistante et l'impression d'un âge d'or inégalé depuis. Vingt-cinq ans après, la nuit est-elle encore un lieu de culture alors que le DJ David Guetta vante les mérites d'un gel coiffant party proof (résistant aux soirées) et que Jean Roc et le VIP Room accueillent la Star'Ac, quand Emaer recevait David Bowie ?
BONHEUR CHIMIQUE
"Celui qui dit qu'il ne se passe plus rien dans la nuit parisienne est un idiot." Depuis sept ans, Frédéric Taddeï l'observe derrière l'objectif de sa caméra pour l'émission "Paris dernière" sur la chaîne du câble Paris Première. Et rien ne l'agace plus que cette nostalgie d'un âge d'or Palace. "C'était un moment exceptionnel, mais après la mort de Fabrice Emaer (en 1983) le Palace n'était plus que l'ombre de lui-même. L'arrivée de la techno, des raves dans les années 1990 a fait tout exploser. Tout à coup, on faisait la fête dans des usines, dans des stations de métro désaffectées." Carburants de ces nouvelles fêtes : une nouvelle drogue, l'ecstasy - dont le bonheur chimique s'oppose radicalement à l'extase solitaire de l'héroïne des deux décennies précédentes - et le désir de retrouver une mixité sociale oubliée avec le temps. Et la danse à outrance comme ersatz d'une liberté sexuelle contrariée par le sida.
Ce sont les années Queen, Folies Pigalle, Rex, qui donneront naissance à de nouveaux lieux comme le Pulp, le Batofar. Les années Radio-FG, Radio-Nova, stations qui accueillent tous les DJ en vogue. Une époque qui n'est plus définie par un seul lieu et dont la fragmentation s'accompagne d'une frénésie créative. Musicalement, avec la naissance d'une scène française internationalement reconnue (Daft Punk en tête), mais aussi en matière d'images. Les flyers (cartons d'annonce des soirées) et pochettes de disques vinyle deviennent le support privilégié d'une nouvelle génération de graphistes : Geneviève Gauckler travaille avec le label F Communications (Laurent Garnier), le collectif H5 définit l'image du label Solid (Etienne de Crécy), la Shampouineuse recycle avec humour les années 1970 pour les Folies Pigalle et le label Yellow (Bob Sinclar), Kuntzel et Deygas travaillent pour Dimitri From Paris, Lola Duval pour le Batofar. Kuntzel et Deygas ont été choisis par Steven Spielberg pour le générique d'Arrête-moi si tu peux. Leur style a contaminé les magazines, la French touch a habillé publicité et émissions de télévision.
Vingt-cinq ans après, la nuit a radicalement changé. "Aujourd'hui, le monde du clubbing officiel est devenu un supermarché. La création n'est plus dans ces espaces-là depuis longtemps" , estime David Bordes, responsable communication du Nouveau Casino, une petite salle de 380 places qui alterne concerts et soirées. "La nuit innovante des années 2000, explique-t-il, est repartie dans la sphère privée. On la doit à des associations comme We Love Art ou Une nuit, qui 'squattent' les panneaux d'affichage publicitaire pour en faire des œuvres éphémères et qui organisent des soirées à l'atmosphère originale." Frédéric Taddeï la situe ailleurs : "Avec les conséquences du sida, le sadomasochisme est devenu le seul rapport sexuel prophylactique. Les gens viennent de toute l'Europe aux soirées fétichistes Démonia, par exemple. Et j'y vois une créativité vestimentaire incroyable. Toute l'esthétique SM s'est diffusée depuis dans les magazines et dans la société."
RAVE ET GUINGUETTE
Et puis il y a les bars, les vedettes de ces dernières années. Version chic et glamour au Mathy's, "un endroit réservé à une catégorie de noctambules qui ont quelque chose à raconter. C'est là que va Mick Jagger aujourd'hui quand il est à Paris" , confie Frédéric Taddeï. Sofia Coppola, elle, choisit le Baron, le dernier des endroits à la mode, un ancien bar à hôtesses avenue Marceau acheté par le graffeur André et par les organisateurs de soirées La Johnson. Les branchés moins fortunés ont investi leurs versions populaires : les Neuf Billards (10e), le Truskel (2e), le Soleil de la Butte (18e). Ils y organisent des soirées ouvertes à tous, avec trois francs-six sous mais un fichier d'adresses électroniques et un réseau d'amis et de relations médiatico-culturelles bien garnis.
Voilà à quoi ressemble la nuit d'aujourd'hui. Autogérée, à cheval entre la sphère publique et la sphère privée, créative dans ses interstices, ses espaces de liberté insoupçonnés. Une nuit toujours un peu plus décalée aussi, jusqu'à se dérouler de jour "parce que, à force de vivre la nuit, on cherche aussi à en sortir" , déclare Dimitri, programmateur du Nouveau Casino, C'est ainsi que lui est venue l'idée des après-midi Sous la plage, organisées au parc André-Citroën depuis trois étés. Là, au milieu des poussettes et des familles, se déroule "un hybride de rave et de guinguette" .
Odile de Plas
Article paru dans l'édition du 07.06.05
Le souvenir du palace hante la nuit parisienne
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers All of These things and more
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités