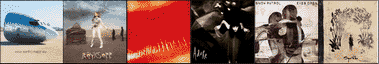“Le rock m’a sauvé la vie”
Son enfance à Oran, son père… On a longtemps cru le pionnier de la pop française lisse et insouciant, alors qu’il fuyait son passé. Aujourd’hui, il casse son image.
Ni rock ni variété, tout simplement pop, Etienne Daho. Un terme qui n’existait pas encore pour qualifier un artiste français avant le sacre du Rennais natif d’Oran, en 1986. Cette année-là, le jeune homme aux allures d’éternel ado sortait de son doux cocon de chanteur branché anglophile pour faire tomber la France sous la note de son très romantique et synthétique Pop Satori. Vingt ans après, Etienne Daho, archétype de la vedette « années 80 », est toujours là, au sommet. Pas en chef de file surmédiatisé d’une quelconque famille du show-biz. Mais en valeur sûre et tranquille aux faux airs de poids plume, libre et insaisissable. A 50 ans, cet infatigable défricheur de sons, toujours à l’affût des talents d’hier et de demain, est devenu le grand frère de toute une génération, d’Air à Phoenix : celle d’une chanson rock française moderne, affranchie du complexe anglo-saxon. Ni pâle imitateur ni roucouleur rétrograde, Daho a ouvert la variété hexagonale à une langue musicale aux horizons infinis. S’il s’apprête, dans quelques jours, à interpréter, à l’Olympia, son album de 1986 dans son intégralité, il s’agit avant tout d’un clin d’œil, d’une parenthèse enchantée dans son parcours en mouvement perpétuel. Car Daho ne cesse d’avancer. Longtemps pour fuir son douloureux passé. Désormais pour affronter, serein et confiant, l’avenir. Dans sa semi-retraite d’Ibiza, le plus convivial et accueillant des reclus nous a reçu. Pour partager des souvenirs, en toute sincérité.
Pourquoi revisiter l’album Pop Satori à l’Olympia, vingt ans après ?
Très jeune, j’ai été propulsé du statut d’étudiant en anglais à celui de chef de file de la pop française. C’était terrifiant. J’ai toujours détesté qu’on me regarde. Une partie de moi voulait vendre des millions de disques, l’autre vivait dans la crainte d’être vu. Je me voyais en outre comme un imposteur, les artistes que j’aimais me paraissaient dix fois plus talentueux que moi. A 50 ans, je me confronte au jeune homme sautillant, à la mode d’autrefois.
Cet Olympia qui vous a consacré, en 1986, était le triomphe d’une certaine gaucherie, la reconnaissance d’un chanteur non formaté…
Si gaucherie signifie sincérité, d’accord. Mais je ne pense pas avoir exploité mes faiblesses, au contraire, j’aurais aimé les masquer. Je m’y suis efforcé pendant longtemps. Jusqu’au moment où je me suis dit : « A quoi bon ? »
Sur scène, vous tourbillonniez tel un papillon. Comme vous le faisiez, petit, sur les tables de l’épicerie-bistrot de votre grand-mère, à Oran ?
Ma vie n’est rien d’autre que la perpétuation de cette émotion intense. Cette épicerie, avec son juke-box, est toujours là, au fond de moi. Comme une lumière, un feu intérieur qui m’a évité de couler. A l’époque, je quémandais une pièce aux clients et je dansais sur une table pour eux. On m’appelait le twisteur. Et j’ai reproduit cette scène vingt ans après ! L’atmosphère d’Oran, je la retrouve ici, à Ibiza. Il y a les garages à bateaux plus bas, comme ceux de mon enfance. Je me souviens très bien, et pourtant j’étais vraiment petit, des odeurs, de la végétation, du son de la mer. J’en ai besoin. L’album Eden, en 1996, évoquait ce sentiment du paradis perdu que j’avais jusqu’alors tenu à distance pour continuer d’avancer. J’allais tout le temps vers le nord, en Angleterre par exemple, où j’ai écrit cet album. Mais la pochette était explicite : moi de dos, face à la mer, et, au verso, de face, souriant.
L’Algérie, vous ne voulez pas y retourner ?
C’est trop dangereux. Dans ma tête, le cap Falcon, à Oran, est comme un phare, essentiel à mon équilibre. Dedans, il y a toute mon enfance, de la candeur, de la joie, du soleil. Et de la force, parce que c’était aussi très douloureux et difficile, je voyais ma mère souffrir. On n’oublie pas ces choses-là. Lorsque je suis parti à Londres, cette lumière pourtant s’est éteinte. J’étais désorienté, j’avais très peur de me perdre. A présent, je suis maître de moi, y compris de mes excès. Mais je crains de retourner là-bas et de découvrir que tout est abîmé, que cette magie sur laquelle je me suis bâti a disparu... Je ne veux pas risquer de tout foutre en l’air.
Votre chanson Duel au soleil est devenue, avec le temps, une métaphore de votre rapport à la terre natale, mais aussi à votre père, qui porte le même prénom que vous...
Les chansons prennent souvent sens après avoir été écrites. En 1991, alors que mon album Paris ailleurs marchait très bien, mon père est mort. Sur le moment, je n’ai pas su affronter ce décès. Je l’ai mis dans un carton en pensant : « On verra ça plus tard. » Et ça m’a explosé à la figure. J’ai réalisé que je m’étais entièrement construit, tant bien que mal, sans mon père. Ce type qui était juste un repère un peu vague que je ne voulais pas revoir – j’avais des griefs justifiés – n’était plus. J’ai pris conscience que cette absence était définitive. Ça a été terrible.
Il vous avait abandonné ?
Oui. Mon père était militaire, mais aussi un musicien qui aimait faire la fête et avait les moyens de le faire. Rentier, il n’a jamais vraiment travaillé. De loin, cela peut sembler sympathique. Mais j’ai toujours refusé ce qu’il était. Je me souviens précisément du moment où il nous a laissés, en Algérie. Il est arrivé en Jeep, avec un autre militaire. Il m’a pris dans ses bras, m’a serré très fort, et il est parti. En trombe. J’ai su qu’il nous avait quittés pour de bon parce que après nous étions coincés en Algérie, avec ma mère et mes sœurs. Sans l’autorisation du père, on ne pouvait quitter le territoire. C’était la guerre, on a failli mourir plusieurs fois. Petit, je fuguais beaucoup. Ma mère devait travailler et angoissait de ne plus pouvoir me surveiller. Je me suis donc retrouvé en pension, à 4 ans, à l’écart d’Oran. Ça me protégeait. Deux ou trois ans plus tard, nous sommes venus en France, à Reims, puis à Rennes. Et je n’ai revu mon père que bien des années après. Il a réapparu un soir dans les coulisses de l’Olympia… Je n’ai pas voulu le voir. J’avais mis suffisamment de temps pour oublier, je n’avais pas envie de vaciller à nouveau. Etienne Daho junior était devenu Etienne Daho et je me voyais comme quelqu’un de neuf, sans histoire.
Vous avez grandi dans quel univers ?
Avec ma mère et mes sœurs aînées, nous habitions une cité. On n’avait pas de voiture, pas de téléphone, rien du tout. Une vie très spartiate, à l’opposé de l’image qui me colle à la peau, celle d’un petit bourge, un peu BCBG. Dans ma famille, on n’était pas très intéressé par la culture. En arrivant à Rennes, mes résultats scolaires étaient déplorables. Une de mes tantes, très sévère, m’a alors pris en main, m’a appris à réfléchir. Chez elle, j’ai découvert le cinéma, les livres et, surtout, la musique.
La musique était présente chez vous ?
Ma mère écoutait beaucoup Dionne Warwick, Sinatra, Presley, des choses que j’ai mis du temps à apprécier. Petit, j’adorais les yé-yé, c’était dorlotant. Je pense que ça me ramenait à ce juke-box, en Algérie. Il y avait le premier Beach Boys aussi, Surfin’ Safari. La pochette, super belle, avec la Jeep jaune. Mon père avait ce disque, et les Beach Boys, du coup, étaient mon unique lien avec lui. Ce disque, je l’écoute encore, il est dans ma voiture ! Plus tard, mon goût ne s’arrêtait pas sur les choses dont on parlait partout. J’étais très attiré par la Motown, les Marvelettes, Marvin Gaye. Le son de cette musique noire m’a captivé. J’ai aussi été fasciné par Syd Barrett, de Pink Floyd. Le rock m’a ouvert les portes, sauvé la vie. J’avais des amis, en classe, avec qui on a découvert ensemble le Velvet Underground, Bert Jansch, des artistes que personne ne connaissait. Un disque en amenait un autre, et ainsi de suite.
Sortir ce soir est un de vos titres phares. Avant 30 ans, c’était une nécessité, passé 30, c’est devenu un devoir ?
Souvent, on me demande : « Alors, vous sortez toujours ? » Sortir, pour moi, a un sens plus large qu’aller en boîte. Ça signifie sortir de son univers, avoir une curiosité pour le vivant. Partout dans le monde, les gens sortent, même si ce sont juste des petits vieux qui se retrouvent au café, comme en Espagne. Ils boivent leur vin jusqu’à ce qu’ils meurent. J’espère que ce sera pareil pour moi. En Angleterre, aussi, sortir est vital. En France, les gens sont très solitaires, casaniers. Passé un certain âge, la télé ou Internet servent d’alibi. On se donne l’impression de communiquer avec l’extérieur par son écran de télé ou d’ordinateur. Mais communiquer, c’est parler, s’engueuler, se confronter à l’autre.
Confrontation, ce n’est pas un mot auquel on vous associe beaucoup...
On ne peut pas durer aussi longtemps si on n’est pas un guerrier. Mon statut me permet d’aider ceux en qui je crois. Brigitte Fontaine est revenue sur scène grâce à moi, j’en suis fier. Comme d’avoir travaillé avec Jacno, Daniel Darc, Françoise Hardy ou Elli Medeiros. J’essaie d’ouvrir des brèches sonores, musicales. Quand les gens me disent qu’ils ont découvert Jesus and Mary Chain ou Morrissey grâce à moi, ça me met en joie. Imposer certains artistes est un vrai combat. On rêve toujours de forcer des portes plutôt que de céder à la pression de la majorité. C’est ce qui s’est passé en 1986, avec Pop Satori. Une porte s’est ouverte et tout le monde s’est engouffré. Tout à coup, avec Elli, Taxi Girl…, nous étions une génération qui squattait une partie du Top 50.
Cette nouvelle chanson française « d’auteur », Bénabar, Delerm et les autres, vous en pensez quoi ?
Je la connais peu, elle ne m’attire pas. J’envie les Anglais, leur aisance, leurs mots qui sonnent tout de suite. En France, c’est très important d’être littéraire, et moi je me fous d’être littéraire. Je veux trouver les mots qui, mariés au son, vont provoquer une sensation fulgurante, exacte. Pas frelatée. Et parfois, j’y arrive, je crois. Avec Eden, en tout cas, j’ai eu l’impression d’atteindre ce but, de trouver enfin ma liberté. Tout à coup, mon brouet, ce mélange d’influences qui me caractérise, devenait un style : je pense au duo avec Astrud Gilberto, Les Bords de Seine. Ça pouvait être tout, du rap, de l’électro, de la musique brésilienne, de la chanson française, un peu tout ça à la fois. A l’arrivée, ça donne quelque chose de totalement différent de ce qui se faisait en France à l’époque. A tel point qu’on me l’a jeté à la gueule. Eden a été validé à l’étranger avant d’être accepté en France. Parce nous sommes encore le pays de Johnny, où la dance ou l’électro, c’est toujours de la « musique de pédés ».
En 1992, avec l’album Urgence, vous vous engagez clairement dans la lutte contre le sida…
C’était nécessaire. A l’époque, le sida était comme la peste pour la plupart des gens. Quand j’ai appelé les artistes pour leur demander de participer au projet, j’ai essuyé énormément de refus : ils ne voulaient pas être associés à ce combat. Les Restos du cœur, pas de problème, mais le sida, non. Puis j’ai rencontré Patrick Bruel sur un plateau télé – on était alors en pleine bruelmania –, et il a accepté. A partir de ce moment-là, les gens ont dit « oui ». Tout le monde voulait en être.
Et, peu après, il y a eu ces rumeurs selon lesquelles vous mouriez du sida à Londres…
Cette rumeur malveillante est venue de mon implication dans l’album Urgence. Les gens raisonnent ainsi : s’il s’implique, s’il milite, c’est qu’il est séropositif. Ils ne l’ont pas pensé de Patrick Bruel, mais Isabelle Adjani a subi le même sort. Ça arrive dès qu’on n’est pas dans la communication à outrance, la maîtrise d’une image publique. Cette rumeur sordide tombait au moment où j’étais au plus mal à la suite de la mort de mon père. J’étais déjà à Londres, je l’ai appris là-bas, je ne me cachais pas pour mourir. Un copain m’a appelé et, au début, ça m’a fait rire. Mais cette histoire a duré pendant dix ans. Je connaissais tellement de personnes qui étaient malades que dire que j’allais bien équivalait à les montrer du doigt, à me désolidariser. Alors je n’ai rien dit. Et puis au nom de quoi aurais-je dû présenter un bulletin de santé ? Eden est vraiment né de ça, un disque sans compromission, avec du plomb aux pieds, qui n’avait de comptes à rendre à personne, sauf à moi-même.
A Ibiza, vous vous tenez au courant de ce qui se passe dans le monde ?
Je regarde TV5 Monde, les news. Loin du tourbillon, j’ai le temps de digérer la difficulté et l’horreur de certains événements. En ce moment, ce n’est pas ce qui manque. Ces types qui arrivent du Sénégal dans leurs pirogues, ça me fait mal physiquement. Un mec qui dort sur un carton dans la rue, ça me flingue pendant plusieurs heures. Mais je ne sais pas écrire de chansons là-dessus.
A Star academy, où vous êtes passé encore récemment, l’essentiel est d’avoir une grosse voix. Et pourtant, on est le pays des gens « sans voix », de Gainsbourg à… Daho.
C’est un débat sans fin et j’ai renoncé à m’y intéresser. C’est effectivement la puissance de la voix qui fait le talent dans ces émissions. C’est ce qu’on nous vend et c’est ce que pense, du coup, la majorité du public.
Ça vous touche, ces réflexions, ces moqueries ?
Forcément. C’est mon métier. Allez dire à un boulanger que son pain n’est pas bon ! Mais la question est plus compliquée. J’ai mes propres références vocales, comme Leonard Cohen, Chet Baker, Eno ou Caetano Veloso. Aucun n’est un virtuose du chant et pourtant ils me touchent au plus haut point.
Et les talk-shows ?
Longtemps je n’ai pas voulu y aller. Parce que je suis un homme du passé qui préfère le mystère. Je n’ai rien à cacher, mais je n’ai pas envie de communiquer sur ma vie privée. Avant, parce que j’en souffrais trop, aujourd’hui, parce que ça m’appartient. Quand est sorti le live Sortir ce soir, en 2005, qui a remporté un succès énorme, je suis allé dans les talk-shows que j’avais toujours refusés, comme celui d’Ardisson. A force de discrétion, on ne vous connaît plus. Je n’étais plus qu’un être flou, quelques chansons et c’est tout. Cela devient gênant de laisser les autres parler à votre place. Je suis dans la vie, je ne suis pas un reclus, et il y a des images clichés – fils de bourge, léger, insouciant – qui me poursuivent et ne me correspondent pas. J’ai eu envie de le dire.
Propos recueillis par Hugo Cassavetti
Entretien Etienne Daho
Edited By VIOLATION on 1163852812