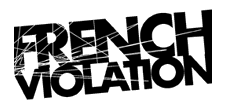On continue avec le suivant !
4.Pretty Girls Make Graves
D'entré le décors est planté:Basse,Batterie,voix et guitare rythmique jouant avec la stéréo débarquent ensemble!
Pourtant l'équilibre du morceau est encore une fois bien fragile,la fin à la guitare du break à commencé à 0:38 nous préviens de ce qui viendra plus tard...
Une voix féminine intervient à 1:28, les notes de la pochette nous apprenent qu'il s'agit de Annalisa Jablonska.
à partir de 1:40 on remaque que la guitare dédouble les notes de sa mélodie de base ce qui est assez sympathique.
Le Break de 2:40 est marqué par un éloignement de la guitare et de la batterie.
Le final à partir de 3:02 nous entraine dans une mélodie pleine d'espoir pressentie plus en amont mais hélas trop courte.
Meilleurs albums des smiths
53 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Je finirai un autre jour je pense si mes commentaires interressent car c'est assez long à disséquer 
A++
JM
JM
-

jmsmirnoffice - Admin
- Messages: 7715
- Inscription: 14 Sep 2003, 20:29
- Localisation: Rueil Malmaison
En complément de l’analyse de jmsmirnoffice et pour les anglophones, une description des chansons du premier album.
Les descriptions portent surtout sur les thèmes abordés voire les anecdotes qui s’y rattachent ( Source : information from answer.com ) :
"Reel Around the Fountain", a track about lust and deflowering, opens the album, Morrissey's subdued vocal being backed by equally subdued drum, guitar, piano, and organ tracks.
"You've Got Everything Now" and "Miserable Lie" combine catchy, powerful choruses with more serious and simpler verses to good effect.
"Pretty Girls Make Graves" is a song about the inability of an adolescent ( some have speculated homosexual ) man to fulfill his culture's stereotyped sexual/relational expectations: I could have been wild and I could have been free / but nature played this trick on me / She wants it now and she will not wait / but she's too rough and I'm too delicate, sings Morrissey.
The stunning falsetto of the chorus is complemented by a powerful and effective barrage of tom drums, while the verses see a prominent bassline being supported by excellent guitar work. The strong musical and lyrical components of the song make it one of The Smiths' best remembered.
"The Hand That Rocks the Cradle" a song that some believed was about child molestation ( an accusation vehemently denied ), follows. Although it features a looping guitar part, the song adds or amplifies instruments, keeping it interesting throughout.
Morrissey's lyrics contain no verse-chorus structure, giving the song the feel of a poem set to music, which somehow makes it strangely beautiful. At one point, it was considered to name the album after this track but in the end they went with the simpler The Smiths instead.
"Still Ill" and "Hand in Glove", a remix of the band's debut single follow.
They are more traditional pop tunes made interesting by Marr and Morrissey's unique style. The former sees the singer ruing the attraction of a person with whom he desires no relationship, while "Hand in Glove" is, in Morrissey's words, "the most important song ever written".
It appears to be an us-versus-the-world love song, until the song's last lines reverse the feeling into doomed romanticism.
"What Difference Does It Make" is a punk-influenced rock track that became the album's best selling single.
"I Don't Owe You Anything" is a swaying track about a particularly forceful relationship.
"Suffer Little Children", a song about the Moors Murders, closes the album.
With a similar structure and subject matter to "The Hand That Rocks the Cradle", the song is sung from the perspective of the children who had been murdered. Its poetic nature and subtle musical backing make it a memorable closer.
"Suffer Little Children" was the first song that Morrissey and Marr wrote together on that memorable day in 1982 when they first met.
2006 est l'année où l'on reparle beaucoup des Smiths.
Voir ici ce qui est à venir ( biographie de Johnny Marr, réédition d'une Bio des Smiths, sortie d'un DVD, ... )
Edited By what_ever on 1148226760
Les descriptions portent surtout sur les thèmes abordés voire les anecdotes qui s’y rattachent ( Source : information from answer.com ) :
"Reel Around the Fountain", a track about lust and deflowering, opens the album, Morrissey's subdued vocal being backed by equally subdued drum, guitar, piano, and organ tracks.
"You've Got Everything Now" and "Miserable Lie" combine catchy, powerful choruses with more serious and simpler verses to good effect.
"Pretty Girls Make Graves" is a song about the inability of an adolescent ( some have speculated homosexual ) man to fulfill his culture's stereotyped sexual/relational expectations: I could have been wild and I could have been free / but nature played this trick on me / She wants it now and she will not wait / but she's too rough and I'm too delicate, sings Morrissey.
The stunning falsetto of the chorus is complemented by a powerful and effective barrage of tom drums, while the verses see a prominent bassline being supported by excellent guitar work. The strong musical and lyrical components of the song make it one of The Smiths' best remembered.
"The Hand That Rocks the Cradle" a song that some believed was about child molestation ( an accusation vehemently denied ), follows. Although it features a looping guitar part, the song adds or amplifies instruments, keeping it interesting throughout.
Morrissey's lyrics contain no verse-chorus structure, giving the song the feel of a poem set to music, which somehow makes it strangely beautiful. At one point, it was considered to name the album after this track but in the end they went with the simpler The Smiths instead.
"Still Ill" and "Hand in Glove", a remix of the band's debut single follow.
They are more traditional pop tunes made interesting by Marr and Morrissey's unique style. The former sees the singer ruing the attraction of a person with whom he desires no relationship, while "Hand in Glove" is, in Morrissey's words, "the most important song ever written".
It appears to be an us-versus-the-world love song, until the song's last lines reverse the feeling into doomed romanticism.
"What Difference Does It Make" is a punk-influenced rock track that became the album's best selling single.
"I Don't Owe You Anything" is a swaying track about a particularly forceful relationship.
"Suffer Little Children", a song about the Moors Murders, closes the album.
With a similar structure and subject matter to "The Hand That Rocks the Cradle", the song is sung from the perspective of the children who had been murdered. Its poetic nature and subtle musical backing make it a memorable closer.
"Suffer Little Children" was the first song that Morrissey and Marr wrote together on that memorable day in 1982 when they first met.
jmsmirnoffice a écrit::fletch: enfin une single box des Smiths! exprés pour moi!! Là je suis déjà fou,je vais pas pouvoir attendre...
2006 est l'année où l'on reparle beaucoup des Smiths.
Voir ici ce qui est à venir ( biographie de Johnny Marr, réédition d'une Bio des Smiths, sortie d'un DVD, ... )
Edited By what_ever on 1148226760
Les excès de la liberté mènent au despotisme ; mais les excès de la tyrannie ne mènent qu'à la tyrannie. ( Chateaubriand )
-

what_ever - Messages: 1055
- Inscription: 17 Nov 2003, 17:49
En attendant de finir ma critique du premier album, en voici deux issues de pop-rock.be:
Edited By jmsmirnoffice on 1148818457
[/color]<span style='font-size:12pt;line-height:100%'>The Smiths : "Meat is murder" </span>
Born to be Wilde
mardi 20 avril 2004, par [color=red]Jérôme Delvaux
En 1984, alors que les Nouveaux Romantiques commencent à virer kitsch et que la new wave est récupérée par des groupes comme Duran Duran, Simple Minds et Spandau Ballet, la découverte de The Smiths est assimilée à une résurrection. Un journaliste français dira fort judicieusement au sujet de cette période : « (...) heureusement les Smiths n’allaient plus tarder à arriver et à nettoyer toute cette saleté ». Outre l’unanimement acclamé album éponyme et un Strangeways here we come accouché dans la douleur, le groupe nous a laissé Meat is murder et The Queen is dead, deux authentiques chef-d’œuvres dont on mesure difficilement l’énorme impact aujourd’hui. La Reine n’est pas morte, The Smiths bien... Mais pas dans nos cœurs ni nos esprits.
Dégoûtés par les horreurs du rock progressif, les poses de frimeurs des dinosaures du rock et par l’invasion de l’infâme disco sur les ondes, les punks ont donné un énorme coup de pied dans la fourmilière, avec les conséquences que l’on sait. Après un tremblement de terre ou une guerre, il faut reconstruire. C’est au départ de Manchester, avec Joy Division, qu’une nouvelle scène (appelée par le terme générique « new wave » qui deviendra vite passe-partout) va voir le jour. Il ne faut que quelques années pour que tout reparte en couilles. Synthés pachydermiques, poses ridicules et parodies honteuses du glam de Roxy Music sont près de tout foutre par terre. L’esprit du rock des années 50 et 60 est-il définitivement mort et enterré ? Non ! Steven Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce, quatre jeunes prolétaires de Manchester, vont en faire la vibrante démonstration.
Les bases sont posées avec The Smiths et le clou est enfoncé avec Meat is murder, qui sort chez Rough Trade en 1985 et cause un nouveau petit séisme dans la conservatrice Angleterre thatchérienne. Mal accueilli par l’establishment, l’album prend directement la première place du hit-parade anglais et porte haut l’étendard du rock indépendant, déjà ravivé par Echo & The Bunnymen, The Cure et quelques autres...
Issu de Moss Side, le quartier irlandais de Manchester dévasté par le chômage, le jeune Morrissey fréquente un collège très dur où les punitions corporelles sont encore d’application. Humiliations et violences font alors partie de son quotidien. Il choisit d’exorciser cette période douloureuse dès la première plage de l’album, avec The headmaster ritual, dont les paroles sentent bon le réglement de compte : « les écoles de Manchester sont dirigées par des goules belligérantes, des salauds, des mollusques à l’esprit fermé » (« Belligerent ghouls run Manchester school, spineless bastards, cemented minds »). Le propos est imagé et transpire toute la frustration accumulée. Malgré son texte empli de haine et de dégoût, Morrissey chante sur un ton extrêmement mélodieux. Nul besoin d’hurler quand les idées sont énoncées clairement et argumentées intelligemment pourrait être le message transmis à ces messieurs du hard-rock ou du heavy-metal. Morrissey évoque les tortures physiques avec amertume mais sans durcir le ton. Pour lui, ces profs qui se font appeler Sir sont tout simplement jaloux des jeunes (« Sir lead the troops, jealous of youth, same old joke since 1902 »). Inutile de le préciser, toute la jeunesse britannique, encore soumise à un système scolaire très strict, se retrouve dans ces paroles et ne tarde pas élever Moz, déjà ainsi surnommé, au statut d’icône.
Et la musique me demanderez-vous ? C’est une belle leçon de rock’n roll, sans artifices ni électronique, tel qu’il fut pensé par les pionniers du genre, avec cette petite touche en plus qu’est l’inimitable jeu de guitare de Johnny Marr.
Rusholme ruffians, deuxième plage, est d’ailleurs d’évidence influencé par Elvis Presley. Le son rockabilly et la guitare acoustique forment un tout fort proche de (Marie’s the name) His latest flame, un hit du King sorti en 1961. A tel point que le groupe jouera parfois His latest flame en intro lors de concerts. L’énorme influence d’Elvis sur les Smiths ne sera jamais démentie, Morrissey allant jusqu’à choisir une de ses photos pour la couverture du 45 tours de Shoplifters of the world unite.
La sincérité totale des textes interpelle autant qu’elle dérange. Lecteur inconditionnel de l’esthète Oscar Wilde (Portrait de Dorian Gray), Morrissey se retrouve bien dans ses personnages de dandys torturés, à la sexualité ambiguë et à la sensibilité exacerbée. Certaines paroles peuvent prêter à sourire, mais Moz n’en a cure. Sur le vibrant single How soon is now (ce titre emblématique des années 80 a fait l’objet d’une reprise par le duo russe t.A.T.u. et est utilisé comme générique de la série américaine Charmed), emmené par une guitare lancinante, il s’apitoie sur son sort et sur sa « timidité d’une vulgarité criminelle ». Il chante qu’il a « juste besoin d’être aimé, comme n’importe quel autre humain » et parle d’une sortie en club où « tu sors seul, tu rentres seul, tu pleures et tu as envie de mourir ». Que d’adolescents solitaires ont dû écouter ce titre en fin de soirée !
Sur le plus léger That joke isn’t funny anymore, il clame le plus sérieusement du monde que « quand on rit des gens qui se sentent seuls, leur seul désir est de mourir »... Et ça ne le fait pas rire du tout.
Cette sensibilité à fleur de peau lui vaut à l’époque une réputation d’homosexuel. S’il n’a jamais accepté de se prononcer sur la question, jugeant à juste titre que sa sexualité ne regarde que lui, Moz se dévoile volontiers en chanson. Ainsi sur I want the one that I can’t have, aucun doute n’est plus permis quant à ses préférences. « Un gamin qui ronge parfois ses ongles et qui a fait de la prison parce qu’il avait tué un policier à 13 ans » serait l’être désiré mais inaccessible (car hétéro) dont il est question dans le titre. Il décrit combien le désir de cette personne tourne à l’obsession et conclut sur le sans équivoque « A double-bed and a stalwart lover, for sure these are the riches of the poor » (« Un lit double et un amant bien bâti, ce sont les richesses du pauvre »).
Violence à l’école (The headmaster ritual), violence en rue (Rusholme ruffians), violence à la maison (Barbarism begins at home), toute forme de violence dégoûte le fragile Morrissey. Ainsi, la plage titre, Meat is murder, est un plaidoyer végétarien qui qualifie de meurtre la consommation de viande. Le bruit des appareils d’abattage et des cris de vaches mises à mort servent d’intro à cette superbe chanson, intense et émouvante, accompagnée par une très belle partie de piano et relevée par un chant sincèrement touché, presque sanglotant.
C’est sur cette note triste que s’achève Meat is murder, un album majeur traitant de sujets sérieux avec des mots simples et sans faux-fuyants ; une œuvre pleine d’introspection, de fragilité et de sensibilité, à des années lumières du rock machiste et agressif.
Edited By jmsmirnoffice on 1148818457
A++
JM
JM
-

jmsmirnoffice - Admin
- Messages: 7715
- Inscription: 14 Sep 2003, 20:29
- Localisation: Rueil Malmaison
[/color]<span style='font-size:12pt;line-height:100%'>The Smiths : "The Queen is dead" </span>
I know... It’s over
mercredi 21 avril 2004, par [color=red]Jérôme Delvaux
« La monarchie en Angleterre n’a aucun sens, elle n’a jamais été utile. La monarchie est une idée fondée sur l’imposture, le meurtre et la fourberie (...) ». C’est par ces mots que Steven Morrissey expliquait, en 1986 dans les Inrocks, le sens à donner à The Queen is dead, titre du troisième album des Smiths. La controverse, les insultes et même les menaces de mort qui ont suivi n’ont en rien muselé l’enfant terrible du rock, sans doute le plus grand incompris de la décennie 80.
En Angleterre, en 1986, la Reine est encore au moins aussi sacrée que le pape au Vatican et que Bruce Springteen en Amérique : interdiction d’y toucher ! Oh, il y a bien eu les Sex Pistols, me direz-vous. Ils ont mis Elisabeth II en couverture de leur album et chanté un plus qu’ironique God save the Queen. Mais voilà, les Pistols étaient des punks, des voyous, des toxicomanes, des anarchistes, des loosers sans foi ni loi. A côté d’eux, Morrissey est perçu comme un intellectuel, quelqu’un d’instruit, un poète qui lit et qui réfléchit à tout ce qui l’entoure... Bref un être sensible et intelligent qui n’a rien à voir, ni de près ni de loin, avec Sid Vicious. Le poids d’un discours dépend aussi de celui qui le prononce. Pour cette raison, des paroles comme « Cher Charles n’as-tu jamais intensément désiré apparaître en première page du Daily Mail dans la robe de mariée de ta mère ? » choquent tout ce que le pays compte de royalistes, de puritains et de conservateurs. Avec le recul, ces paroles sont pourtant plutôt à considérer comme humoristiques, mais voilà, on ne touche pas aux intouchables... Surtout que la même chanson attaque aussi l’église : (« tout ce qu’ils veulent est votre argent »). « Les gens intelligents comprendront le pourquoi de mon propos, tant pis pour les autres » déclare alors un Moz philosophe, désormais persuadé de faire partie d’une certaine élite.
Contrairement à ce que le titre peut laisser supposer, The Queen is dead n’est pas un album concept. Morrissey a bien d’autres comptes à régler. Avec Geoff Travis, patron du label Rough Trade, par exemple, à qui Frankly Mr Shankly est dédié. Insulté de « flatulent pain in the arse », Travis ne s’en sort finalement pas trop mal au vu du long contentieux entre sa société et le groupe. D’autant que le morceau est d’une beauté et d’une richesse mélodique presque encore jamais atteintes.
Récemment élue chanson la plus déprimante de tous les temps par les auditeurs de la BBC6, I know it’s over achève de faire des Smiths les porte-paroles des jeunes solitaires, mal dans leur peau et malheureux en amour. C’est la parfaite chanson mélancolique, avec un rythme simple et une guitare discrète où presque tout repose sur la voix de Morrissey, qui n’a peut-être encore jamais aussi bien chanté. « Si tu es si amusant, pourquoi es-tu seul ce soir ? Et si tu es si terriblement beau pourquoi dors-tu seul ce soir ? » demande-t-il avant de conclure qu’« il est facile de rire, il est facile de haïr mais ça demande un effort d’être aimant et gentil ». Avec les Smiths, l’amour est toujours impossible, trahi et voué à l’échec...
Cette conception est sans doute due aux désillusions vécues par le chanteur. De par sa timidité maladive, son manque de confiance en lui et le doute quant à son identité sexuelle, sa vie sentimentale d’adolescent se résume à un grand vide. Même si ça n’apparaît pas de façon indiscutable (grande tradition mozienne des textes à plusieurs interprétations possibles), Never had one ever traite de son désert sentimental (« un cauchemar qui a duré 20 ans, 7 mois et 27 jours »). La blessure n’est pas encore guérie à en juger par le timbre triste de sa voix...
Eternel adolescent déprimé de 27 ans, Morrissey se promène dans les cimetières le dimanche. Cemetary gates décrit une de ses promenades dominicales où, un livre d’Oscar Wilde sous le bras, il a rendez-vous avec un lecteur des poètes John Keats et William Yeats. Ensemble, ils observent les tombes et ont une pensée pour toutes les personnes défuntes « qui sont nées, ont aimé, ont détesté, ont eu des passions et puis sont morts ». Une situation inexorable que Moz qualifie d’injuste et qui, dit-il, lui donne envie de pleurer... Les Nouveaux Romantiques, les vrais, ne sont pas toujours là où on le croit.
Johnny Marr, souvent discret quant à ce que ces textes lui inspirent, préfère s’atteler à son registre : la musique. Il conçoit la plage titre comme la rencontre du MC5 et du Velvet Underground et s’inspire ouvertement de I can’t stand it, un titre assez rare du Velvet. Connu comme un inconditionnel du groupe new yorkais, il s’amuse aussi aux dépends des journalistes. Quand il compose l’intro de There is a light that never goes out, il est persuadé qu’on écrira que ce morceau fut inspiré par le Velvet. Plus malin, il l’a en fait écrit avec à l’esprit Hitch hike, une chanson de Marvin Gaye reprise par les Rolling Stones en 1965 et qui inspira le Velvet... « Lou Reed et moi écoutions les mêmes trucs », confiait-il au magazine Select, en 1993.
Grand fan des Stones et de Keith Richards en particulier (il lui arrive même d’imiter sa dégaine et son jeu de scène), il rêve de composer un titre qui soit, dans la discographie des Smiths, l’équivalent de Jumpin’ Jack Flash. Le fameux Big mouth strikes again est écrit dans cet esprit. Si au final les deux chansons ne se ressemblent pas vraiment, elles possèdent un côté sombre similaire et la même fougue rock’n roll. Les paroles flirtent allégrement avec l’auto-parodie, la grande gueule en question n’étant autre que Morrissey, qui offre ici aux tabloïds le titre idéal : « la grande gueule a encore frappé ! ». Moz ne renie pourtant pas une ligne de son engagement. Attaqué de toutes parts, il dit dans la chanson comprendre ce que Jeanne d’Arc a dû ressentir sur le bûcher, brûlée pour ses idéaux qui dérangeaient les Anglais. Placebo adore et en enregistra une reprise.
« Comment pouvez-vous me regarder droit dans les yeux et ne pas me croire ? » demande Moz dans The boy with the thorn in his side aux gens qui doutent de sa sincérité. Car la chose qui le touche le plus quand on l’accuse de n’être qu’un poseur artificiel, c’est qu’on mette en doute son intégrité de songwriter. Certains écrivent sur l’amour parce qu’il faut bien vendre, mais lui croit fermement à chaque mot de ses chansons.
Il écrit principalement sur son vécu et les problèmes familiaux sont encore à l’ordre du jour avec There is a light that never goes out. L’histoire est celle d’un jeune qui demande à un ami de l’emmener en sortie pour se changer les idées et voir du monde. En chemin, il implore de ne jamais le ramener à la maison car il n’y est plus le bienvenu et se prend à rêver à un accident mortel. Il chante « mourir à tes côtés serait paradisiaque et un grand privilège pour moi ». Peut-on aller plus loin dans l’expression du désespoir ?
Enfoncés jusqu’au cou dans leur trip « nous préférons être écoutés par 10 personnes intelligentes qui comprennent nos textes que par 100.000 crétins ignares », les Smiths n’ont pas connu le succès populaire qu’ils auraient amplement mérité. 18 ans plus tard et alors que The Libertines, Interpol, Franz Ferdinand et même les Strokes leur revendiquent une filiation, il n’est pas trop tard pour sortir du troupeau et découvrir ce que l’Angleterre a enfanté de plus beau, de plus riche, de plus abouti, de plus audacieux et de plus profond. C’est même indispensable.
A++
JM
JM
-

jmsmirnoffice - Admin
- Messages: 7715
- Inscription: 14 Sep 2003, 20:29
- Localisation: Rueil Malmaison
jb a écrit:The Queen is Dead est sorti il y a tout juste 20 ans cette semaine. :respect:
... et malheureusement, pas de réedition spéciale
J'aurais bien vu une réedition du style de London Calling
A++
JM
JM
-

jmsmirnoffice - Admin
- Messages: 7715
- Inscription: 14 Sep 2003, 20:29
- Localisation: Rueil Malmaison
Un nouveau bootleg culte à posséder ?
"The Smiths - Unreleased Demos & Instrumentals"
The Hand That Rocks The Cradle
Reel Around The Fountain
Rusholme Ruffians
The Queen Is Dead
Sheila Take A Bow
This Night Has Opened My Eyes
Untitled One (Marr Instrumental)
Ask
There Is A Light That Never Goes Out
Is It Really So Strange?
Frankly, Mr. Shankly
Shoplifters Of The World Unite (Reprise)
Girlfriend In A Coma
Death Of A Disco Dancer
Paint A Vulgar Picture
Untitled Two (Marr Instrumental)
Existe en CD et vinyle
Si quelqu'un a un avis sur la bête...
Source Morrissey Solo
Attachment: http://www.frenchviolation.com/board_ht ... sdemos.jpg
"The Smiths - Unreleased Demos & Instrumentals"
The Hand That Rocks The Cradle
Reel Around The Fountain
Rusholme Ruffians
The Queen Is Dead
Sheila Take A Bow
This Night Has Opened My Eyes
Untitled One (Marr Instrumental)
Ask
There Is A Light That Never Goes Out
Is It Really So Strange?
Frankly, Mr. Shankly
Shoplifters Of The World Unite (Reprise)
Girlfriend In A Coma
Death Of A Disco Dancer
Paint A Vulgar Picture
Untitled Two (Marr Instrumental)
Existe en CD et vinyle
Si quelqu'un a un avis sur la bête...
Source Morrissey Solo
Attachment: http://www.frenchviolation.com/board_ht ... sdemos.jpg
But of course darling it's normal
-

jb - Admin
- Messages: 10009
- Inscription: 04 Oct 2001, 14:45
- Localisation: Paris e(s)t sa banlieue
Salut,
J'ai récupéré le rip vynil dès sa mise en ligne sans avoir le temps de l'écouter.
Mais aux vues des commentaires sur le forum ça à l'air d'être du LOURD de chez LOURD:rock:
A+
STUMM ":respect: Motorways" 101
J'ai récupéré le rip vynil dès sa mise en ligne sans avoir le temps de l'écouter.
Mais aux vues des commentaires sur le forum ça à l'air d'être du LOURD de chez LOURD:rock:
A+
STUMM ":respect: Motorways" 101
Bien malin celui qui distingue une fausse note fausse d'une fausse note juste
-----
La plus courte nouvelle de SF : Le dernier homme sur Terre entend frapper à la porte...
-----
La plus courte nouvelle de SF : Le dernier homme sur Terre entend frapper à la porte...
-

STUMM101 - Messages: 11074
- Inscription: 06 Nov 2003, 22:26
- Localisation: Paris
Motorways, c'est le pseudo du père Noël qui est passé en avance cette année ? C'est un must ces démos, de l'or en barre. La démo de Shoplifters est stupéfiante, le petit solo de guitare en intro est étonnante, sauf que ce n'est pas l'intro mais le riff principal de cette intro boeuf.
But of course darling it's normal
-

jb - Admin
- Messages: 10009
- Inscription: 04 Oct 2001, 14:45
- Localisation: Paris e(s)t sa banlieue
Re: Meilleurs albums des smiths
Quelqu'un a t-il acheté l'intégrale remasterisée des Smiths (box 8 CD)?
je me laisserais bien tenter si la qualité de la remasterisation est au rendez-vous.
je me laisserais bien tenter si la qualité de la remasterisation est au rendez-vous.
- rush93
- Messages: 333
- Inscription: 19 Oct 2003, 19:15
Re: Meilleurs albums des smiths
rush93 a écrit:Quelqu'un a t-il acheté l'intégrale remasterisée des Smiths (box 8 CD)?
je me laisserais bien tenter si la qualité de la remasterisation est au rendez-vous.
je n'ai pas les compétences techniques pour apprécier la qualité de la remasterisation et en plus je n'ai pas les albums originaux pour comparer mais je peux t'affirmer que pour 39,90 €, c'est un bien joli coffret que je ne regrette pas d'avoir acheté. Le packaging est simple mais tout est de bonne qualité !
Global Spirit Tour: Amsterdam - Anvers - Lille - Paris - Anvers - Paris - Paris - Copenhague - Amsterdam - Bordeaux - Arras - Hérouville - Paris
-

slowblow73 - Messages: 4840
- Inscription: 01 Avr 2003, 15:21
- Localisation: Lille
Re: Meilleurs albums des smiths
Actus The Smiths à noter en ce mois de mars 2013 :
Un enregistrement inédit des Smiths vient de sortir, 39 minutes qui datent de mai 1983 baptisées "The Pablo Cuckoo Tape" :
http://www.slicingupeyeballs.com/2013/0 ... -may-1983/ A écouter sur youtube ou à télécharger sur Smiths Torrents.
Plus anecdotique, Uncut consacre un hors-série aux Smiths :
http://www.uncut.co.uk/blog/uncut-edito ... -this-week
Un enregistrement inédit des Smiths vient de sortir, 39 minutes qui datent de mai 1983 baptisées "The Pablo Cuckoo Tape" :
http://www.slicingupeyeballs.com/2013/0 ... -may-1983/ A écouter sur youtube ou à télécharger sur Smiths Torrents.
Plus anecdotique, Uncut consacre un hors-série aux Smiths :
http://www.uncut.co.uk/blog/uncut-edito ... -this-week
But of course darling it's normal
-

jb - Admin
- Messages: 10009
- Inscription: 04 Oct 2001, 14:45
- Localisation: Paris e(s)t sa banlieue
53 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Autour de Depeche Mode
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités